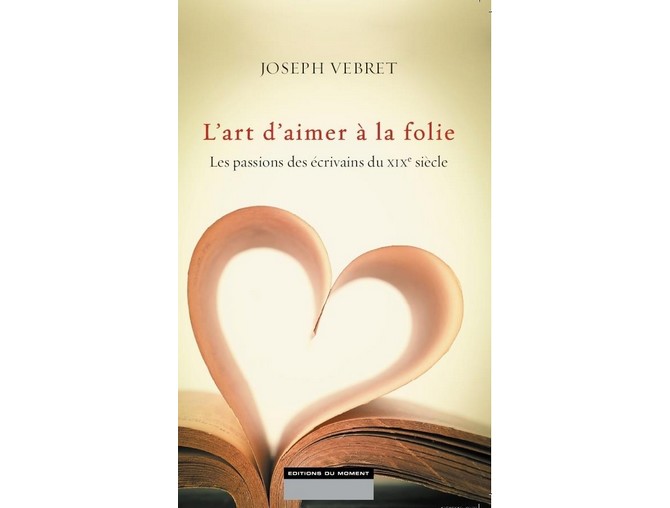Première partie du questionnaire littéraire confié à Joseph Vebret…
Pourquoi avoir choisi cette voie ? Quel a été le déclencheur ?
Une passion précoce pour les mots, pour les phrases, pour les histoires. Mais aussi, très tôt, une curiosité pour les écrivains eux-mêmes – notamment ceux du XIXe siècle, dont la vie fut parfois plus romanesque encore que leurs romans. Fils unique, j’ai grandi dans plusieurs pays étrangers au gré des affectations de mon père qui était enseignant.
Cette enfance itinérante, marquée par l’exil, la barrière de la langue, l’absence de télévision, de téléphone portable ou d’ordinateur dans les années soixante et soixante-dix, m’a confronté très jeune à la solitude et à l’ennui. J’y ai répondu par la lecture – frénétique, compulsive –, et presque simultanément par le désir d’écrire.
C’est ce double mouvement, recevoir et créer, qui m’a conduit vers le journalisme dans un premier temps : un terrain d’apprentissage, de contact avec la langue, les récits du réel, mais aussi une forme d’approche indirecte de l’écriture littéraire. J’ai attendu longtemps avant de publier – à l’âge de 40 ans – mon premier roman, par retenue sans doute, par exigence aussi.
Pourquoi écrire et publier ? Pour la liberté, avant tout. Pour vivre d’autres vies que la mienne, pour explorer les marges, les silences, les obsessions, là où les lignes se troublent. Écrire, c’est avancer à la lisière du visible et du caché ; et tenter de donner forme à ce qui, sinon, resterait muet.
Mon intérêt pour l’écriture – et plus encore pour les écrivains, leurs doutes, leurs éclairs de génie et leurs égarements – s’est rapidement accompagné d’une véritable passion pour l’Histoire, notamment celle du XIXe siècle. Cela m’a naturellement conduit à publier plusieurs récits à dimension historique, nourris de recherches fouillées et de cette obsession du détail qui reconstitue une époque. Par ailleurs, j’ai fondé ou animé plusieurs revues littéraires, lieux de réflexion, de transmission et de compagnonnage intellectuel. Parce qu’une question m’a toujours obsédé : pourquoi écrire ?

En 2002, à 45 ans, j’ai arrêté toute activité salariée pour ne me consacrer qu’à l’écriture. Ce fut une décision radicale, mais nécessaire. J’avais besoin de cette mise en danger pour franchir le seuil, pour ne plus reculer devant cette passion longtemps tenue à distance. Il me fallait couper avec le confort relatif, avec les rythmes imposés, pour affronter enfin la page blanche, sans filet ni échappatoire.
Pour garantir malgré tout quelques subsides, pour faire les fins de mois, je me suis tourné vers l’édition – réécriture, suivi d’ouvrages – mais aussi vers l’écriture pour les autres, en qualité de prête-plume, comme on dit désormais. Ce travail de l’ombre m’a permis de rester au plus près des mots, de continuer à écouter des récits, à les modeler, à leur donner une forme. Écrire à la place d’un autre, c’est aussi apprendre à disparaître, à épouser une voix qui n’est pas la sienne, tout en l’accompagnant au plus juste. Ce fut parfois frustrant, souvent formateur, et cela m’a permis, paradoxalement, d’affiner ma propre voix.
J’ai toujours tenu à faire la part des choses entre la fiction et le récit ou l’essai, même si on peut y introduire pour les besoins du texte une dose de fiction. Ce sont, à mes yeux, des formes distinctes qui exigent chacune un engagement différent, une démarche propre. Le roman, surtout, réclame une lente maturation. Me concernant, il ne peut se plier aux logiques de rendement ou de calendrier éditorial. Il doit rester une forme exceptionnelle, rare, presque sacralisée, où l’on dépose ce que l’on a de plus intérieur, de plus risqué aussi.
Je n’écris pas un roman en pensant au marché, aux ventes, aux chiffres : cela reviendrait à en trahir la nécessité. À l’inverse, le travail sur l’histoire – l’enquête, la documentation, la rigueur des sources – impose d’autres exigences, d’autres méthodes, mais peut, lui, s’inscrire dans un rythme plus soutenu. Ce sont deux régimes d’écriture, deux vitesses du temps que je m’efforce de ne jamais confondre.
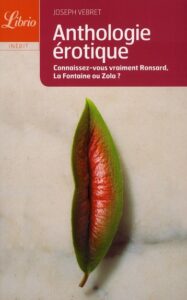
C’est pourquoi je n’ai pas publié de roman depuis 2012. J’avais laissé cette voix en suspens. Mais elle s’est imposée de nouveau. Récemment, j’ai terminé un nouveau roman auquel je tiens particulièrement. Il interroge la part de fiction dans nos souvenirs, les silences familiaux, les identités mouvantes. C’est un texte plus introspectif, plus dépouillé aussi, qui me semble fidèle à ce que je suis aujourd’hui. Il est prêt, désormais, et attend la réponse de quelques éditeurs.
Je ne recherche ni la notoriété ni la construction méthodique d’une œuvre. Pour ce qui est du roman, j’écris quand cela devient nécessaire, quand l’écriture s’impose comme une manière d’ordonner le chaos, d’habiter le temps autrement. Je ne conçois pas la littérature comme un tremplin, encore moins comme une stratégie. Elle est pour moi un geste fragile, vital, souvent solitaire ; une façon d’éclairer l’ombre avec des mots choisis, tremblants, parfois imparfaits, mais salutaires.
Qu’est-ce qui crée l’étincelle d’une histoire ? Qu’est-ce qui la déclenche ?
Je vous répondrai pour le roman, la fiction. Me concernant, l’étincelle vient rarement d’une idée bien formée. Elle surgit plutôt d’un trouble, d’un point de frottement dans la vie réelle, un moment fugace qui résiste à l’oubli, une sensation qui insiste sans qu’on sache pourquoi : une image persistante, une phrase intérieure qui revient, un regard échangé, ou un souvenir qui refuse de s’éteindre. Ce n’est jamais une idée claire. Plutôt une forme d’inconfort, un frisson dans le réel.
Quelque chose m’effleure, me traverse sans me demander la permission, une sensation que je ne parviens pas à nommer. Et cette chose insiste. Elle tourne, elle s’installe, elle obsède. L’étincelle, c’est peut-être cela : l’insistance de ce qui ne veut pas s’en aller. Rien ne commence avec une intrigue, mais toujours avec une faille, une énigme, une présence muette.
L’histoire vient ensuite, tâtonnante, comme un animal qu’on apprivoise. Je n’écris pas pour raconter une histoire : j’écris parce que quelque chose me résiste, me parle à voix basse et me contraint à l’écoute. L’histoire ne naît pas toujours en tant que projet : elle surgit comme une fracture intime qu’on doit explorer.
Parfois, c’est une absence qui déclenche l’écriture : un vide à combler, une question restée sans réponse. Il y a toujours, au départ, quelque chose d’inexplicable qui me hante. Alors je me mets à écrire non pas pour raconter, mais pour comprendre pourquoi cela me poursuit. Et c’est souvent en cours de route que l’histoire se découvre, qu’elle commence à se construire autour de ce noyau incandescent.
C’est d’ailleurs le fil conducteur du roman que je viens de terminer : un écrivain qui, après quinze ans de silence, se remet à écrire à la suite d’un événement apparemment anodin. Et il s’interroge sur les raisons de ce désir de noircir à nouveau du papier.
A suivre dans la deuxième partie. Découvrez ici les livres de Joseph Vebret…