Deuxième partie du questionnaire littéraire confié à Joseph Vebret…
Quelles sont les techniques pour « affronter » une nouvelle ou un roman, le poursuivre coûte que coûte et en venir à bout ?
Affronter est vraiment le mot juste. Écrire un roman revient à s’engager dans une forêt dont on ne connait ni la taille ni la sortie. Il faut une dose de ténacité presque absurde, de confiance aveugle. Je m’impose des rituels simples : écrire chaque jour, même un peu, relire ce que j’ai écrit la veille pour me remettre dans le souffle. J’accepte aussi de ne pas tout contrôler. Il y a des jours où les mots refusent de venir, où le texte me paraît fade, sans direction ; et c’est précisément dans ces moments-là qu’il faut continuer. Je crois que le secret, c’est d’écrire en avançant, sans revenir sans cesse en arrière.
Laisser parfois l’inspiration se taire, mais continuer tout de même, avancer dans le brouillard. Revenir souvent à la source : pourquoi ce texte ? Pourquoi moi ? Il faut aussi accepter l’imperfection du premier jet, se laisser le temps de se relire, de réécrire, de se réinventer. C’est cela : se défaire de l’obsession de bien faire, et s’autoriser à écrire imparfaitement, mais complètement.
La discipline est la seule technique fiable, mais elle doit s’allier à une forme de foi : croire qu’il y a quelque chose au bout du tunnel, même quand tout paraît confus.
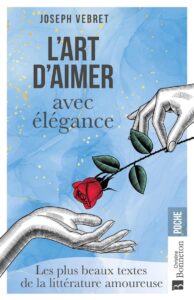
Il n’y a pas de recette. Il n’y a que l’obstination, l’entêtement. Une solitude qui accepte de durer. J’avance dans le noir, parfois sans boussole, en posant une phrase comme on jette une pierre pour mesure la profondeur du puits. J’ai compris qu’il fallait aimer ne pas savoir. Supporter les doutes en cascade. Écrire contre soi-même. Continuer même lorsque tout en soi crie de se taire. Mais il y a toujours ce moment où le texte commence à respirer tout seul. Alors on le suit. C’est un compagnonnage rude, mais terriblement fidèle. Écrire, c’est croire que, derrière le chaos apparent, se cache un schéma secret qui ne sera révélé que par l’action d’écrire.
Écrire est un plaisir demandant des contraintes. Comment trouver le juste milieu entre contrainte et plaisir ?
La contrainte est l’ossature du plaisir : sans cadre, l’écriture se dissout dans le vague. Le juste milieu, c’est de fixer des limites – un genre, une voix, un point de vue, une temporalité… – qui ne brident pas, mais aiguillonnent l’inventivité. C’est aussi savoir quand s’accorder la liberté de déborder. Il faut être à l’écoute : si l’écriture devient torture, il est peut-être temps de s’éloigner un moment. Mais si elle est trop confortable, alors elle risque de ne rien faire naître de vrai.
C’est un équilibre très subtil. Si je n’ai aucune contrainte, je m’égare, je me dilue. Mais si elles sont trop rigides, je m’étouffe. Avec le temps, j’ai appris à rester ouvert à ce que le texte exige de moi. Je crois qu’écrire, c’est comme danser avec une ombre : il faut suivre un rythme, respecter une structure, mais aussi se laisser guider, surprendre, faire parfois un pas de côté.
Le plaisir naît justement dans cet espace étroit entre la règle que l’on s’impose et l’élan que l’on s’autorise. Et puis, certaines contraintes deviennent des plaisirs en elles-mêmes : la recherche du mot juste, le défi de composer une scène, la jubilation d’une phrase qui sonne juste.
J’ai également besoin d’être dans la sensation de l’urgence, dans la tension. Que le texte m’envahisse jusqu’à devenir une obsession qui ne me quittera qu’une fois le manuscrit achevé, relu, corrigé, modifié, prêt à être proposé à un éditeur.
C’est un jeu, mais un jeu sérieux. Le juste milieu ? Il n’est jamais donné : il se négocie à chaque roman, parfois à chaque page. Il faut écouter le rythme de ce qu’on écrit, comme on écoute un cœur battre : trop régulier, il s’endort ; trop erratique, il s’épuise. Écrire, pour moi, c’est se tenir sur cette crête étroite, entre exigence et abandon.
Quelles sources d’inspiration pour écrire ? Simplement l’imaginaire, ou bien la vie personnelle, celles des autres, les médias ?
Tout est matériau. Tout ce qui me touche m’inspire, mais pas toujours de façon directe. L’imaginaire, bien sûr, mais il s’abreuve sans cesse du réel : fragments de vie personnelle, confidences recueillies, lectures, films, journaux, rêves, obsessions. Le plus anodin fait divers peut devenir la matrice d’un roman si l’on y décèle une faille humaine. Le secret, c’est la résonance intérieure : ce qui nous frappe, ce qui nous obsède, ce qui nous touche devient le germe d’une fiction possible.
Je ne crois pas en une inspiration purement imaginaire. L’imaginaire, c’est un filtre – il transforme, il déforme – mais il se nourrit en permanence du réel. La vie quotidienne m’inspire autant que mes souvenirs, mes lectures ou les récits que l’on me confie. Les gens parlent, parfois sans savoir qu’ils livrent un roman entier en quelques mots. Les médias aussi, bien sûr, sont une mine, mais pas pour les faits, pour leurs silences, pour ce qu’ils effleurent sans creuser. C’est souvent à partir d’un détail que quelque chose commence à germer. L’inspiration, pour moi, n’est pas une illumination, mais un travail de veille.
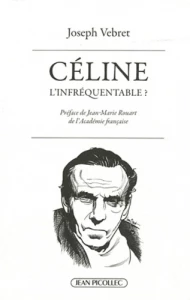
Livre érotique : simple amusement ou bien outil de développement personnel ?
J’ai publié plusieurs livres sur la littérature érotique que j’ai parcourue de long en large, surtout les grands classiques, mais je n’ai jamais écrit de roman érotique en tant que tel. Lorsque je me suis intéressé aux nombreuses maîtresses de Napoléon (Les Amours orageuses de Napoléon) ou à la vie sentimentale des grands écrivains du XIXe siècle (L’Art d’aimer à la folie), pour ne prendre que ces deux exemples, j’ai décrit des scènes crues, mais en cherchant à rester élégant, allusif, au second degré, sans rupture de style.
De même que la sexualité n’est pas absente de mes romans. Mais elle n’est jamais traitée comme un élément spectaculaire. Elle s’impose, le plus souvent, comme une évidence entre deux êtres, une conséquence logique du désir, de l’attirance ou de l’amour. Je la montre sans détour, mais sans fioriture, sans mise en scène excessive : un corps n’est pas une énigme, un acte sexuel n’est pas un climax romanesque. En revanche, ce qui m’intéresse davantage, c’est l’érotisme, dans ce qu’il a de diffus, d’invisible parfois.
Un geste, une voix qui vacille, une mèche de cheveux remise derrière l’oreille, une retenue, une attente, une tension entre deux corps avant qu’ils ne s’abandonnent ; voilà ce qui me touche. L’érotisme, c’est l’art de faire monter le silence jusqu’au frémissement. Ce n’est pas le sexe en tant que tel, mais ce qui l’entoure, l’annonciation du geste, sa possible absence. L’érotisme est un trouble qui ne se dit pas tout de suite, une zone floue où le désir prend le temps de se nommer. Il me semble plus puissant, plus littéraire, car il ouvre un espace à la fois charnel et mental, une vibration du texte lui-même.
A suivre dans la troisième partie. Découvrez ici les livres de Joseph Vebret…

